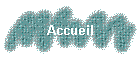  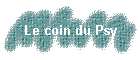 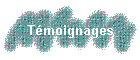 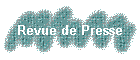 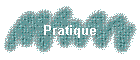


|
Le monitorage
à domicile.
Il m’est demandé aujourd’hui de parler du
MONITORAGE A DOMICILE des enfants ayant fait un malaise.
Mais avant de parler de cette question,
il me paraît important de donner quelques précisions qui vous
permettrons, à vous parents, de mieux comprendre comment notre Centre,
celui de Port-Royal, est doté d’un nombre de moniteurs important.
Bien avant 1986, ( année du décret
ministériel créant officiellement les centres de références ), en
1972, le Docteur Monod, alors chercheur à l’INSERM , travaille à la
compréhension des causes de la MSN ( Mort Subite du Nourrisson ). En
1980, la création de vacations médicales aide cette pédiatre dans sa
recherche et permet de débuter un travail clinique. Parallèlement une
demande d’information, de soutien, d’accueil de la part des parents
touchés par ce syndrome va grandissante.
Pour y répondre, dans un cadre associatif, le
Docteur Monod s’entoure d’une équipe et de moyens ( en particulier
des moniteurs cardiorespiratoires pour la surveillance des bébés « à
risque » à domicile ). En 1986, c’est cette même équipe dotée de
ces moyens qui est officiellement déclarée « Centre de référence »
et rattachée alors au sein de l’AP‑HP, dans le service néonatale
de l’hôpital Cochin dont le chef de service est jusqu’à
aujourd’hui, monsieur le professeur Jean Pierre Relier. Ainsi
actuellement , nous avons l’avantage d’être une équipe
pluridisciplinaire dotée de moyens importants ( 96 moniteurs ), comparée
à d’autres centres, créés, il faut le dire sur le papier, mais pour
la majorité, sans aucun moyen supplémentaire ! Ce « pool » de
moniteurs et cette équipe diversifiée nous permettent, entre autres,
d’utiliser, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative, le moniteur
comme outil de surveillance utile et « anxiolytique », moyen au
demeurant, fort controversé mais qui, dans un cadre d’accompagnement
bien spécifique, s’avère très efficace.
Pour être simple, deux types de malaise sont
à considérer : le malaise, expliqué du point de vue médical, avec un
traitement efficace et bien suivi. Dans ce cas, le moniteur à domicile
est proposé aux parents qui le désirent, avec ses avantages et ses
inconvénients. Il fait partie de l’arsenal mis à la disposition des
familles et de l’équipe soignante pour essayer, autant que faire se
peut, de diminuer l’inquiétude des parents et donc d’augmenter le
confort de la relation avec leur bébé. Le moniteur est proposé aux
familles comme quelque chose qu’ils auraient à gérer eux-mêmes et qui
n’est, bien entendu, pas obligatoire. Alors que les différents examens
et traitements sont gérés par l’équipe médicale et présentés comme
très nécessaires voir obligatoires. Si les parents décident d’essayer
le « monitorage », une formation leur est donnée ( c’est ce que nous
appelons la « remise de moniteur » ). Puis le branchement de
l’appareil est géré en fonction de l’inquiétude parentale, c’est-à-dire
qu’aucune règle n’est établie : branchement durant le sommeil du bébé
ou durant le sommeil des parents ou encore lorsque tout le monde dort ou
essaie de dormir ! Il peut même arriver, cas il est vrai rarissime, que
le moniteur, véritable objet « contrat‑phobique »,
reste dans le placard !
Je me rends compte aujourd’hui que, de cette
façon, nous permettons aux parents de s’approprier encore plus leur
enfant en étant, pas seulement « exécutants » passifs des décisions
prises autour de la prévention, mais aussi acteurs à part entière et
cela les aide beaucoup à mieux investir ce bébé.
Lorsque le malaise n’est pas totalement
expliqué sur le plan médical, qu’il existe éventuellement des récidives,
que le traitement ne paraît pas complètement efficace, dans ce cas, le
moniteur est une prescription médicale à part entière et celui-ci est
alors géré moins librement par la famille; il est le plus souvent branché
en permanence, conseil de l’équipe médicale qui en explique les
raisons aux parents. Ceux-ci, généralement, acceptent bien cette
contrainte supplémentaire du traitement.
Par la suite, l’enfant grandissant et les
risques diminuant, le branchement du moniteur sera moins fréquent (
seulement pendant le sommeil de l’enfant, puis seulement pendant la nuit
) jusqu’au sevrage total qui n’est évidemment jamais imposé par l’équipe.
Il est à noter que dans ce type de malaise, l’urgence médicale est au
premier plan et il est rare que les parents demandent, de façon
concomitante, une aide spécifiquement psychologique. Ils font confiance
à l’équipe médicale et ne voient pas l’intérêt d’une aide «
psy ». Par contre, un peu plus tard, lorsque l’urgence est dépassée,
que le bébé a grandi, qu’il va mieux, et que par conséquent la peur
s’estompe, ils demandent parfois à me rencontrer. Ce n’est alors pas
pour parler du moniteur lui-même mais pour aborder des problèmes autres
: difficultés de sommeil, difficultés alimentaires, problème avec l’aîné,
problème de couple etc.. Il faut donc en conclure que, là aussi, le
moniteur s’avère être une aide non négligeable pour les parents.
Au-delà des classiques avantages et inconvénients
du moniteur décrits dans de nombreux articles et sur lesquels nous ne
reviendrons pas ici ( sonneries intempestives, réveils nocturnes,
troubles du sommeil, sevrage difficile etc..), je voudrais encore vous
entretenir d’une enquête réalisée ces trois dernières années à
l’aide d’un questionnaire proposé aux familles lorsqu’elles
rapportent le moniteur. Les résultats montrent que lorsqu’un moniteur
est demandé par la famille ou prescrit par un médecin, et après
discussion objective avec un membre de l’équipe et qu’il est géré
par les parents en accord avec l’équipe soignante ( c’est-à-dire
branché en fonction de leurs besoins et des besoins du bébé ),
accompagné d’une prise en charge pluridisciplinaire réelle, un
moniteur n’est quasiment jamais vécu comme angoissant.
Certes quelques critiques négatives sont
relevées ( en particulier, les sonneries et les problèmes liés aux électrodes
) mais le moniteur est toujours vécu comme « rassurant ».
Auparavant, une étude que j’avais menée
personnellement sur la mesure de l’anxiété chez les parents ne
montrait pas de variation significative de celle-ci lors de la mise ou non
sous moniteur. En d’autres termes, le moniteur ne rend pas les parents
plus anxieux, du moins, et c’est important de le souligner, dans le
cadre d’une prise en charge telle qu’elle est faite à Port-Royal.
L’affinage des résultats montre même que les parents qui demandent un
moniteur sont, globalement, moins anxieux à la base que les autres.
Alors que l’on cesse de colporter, sans données
objectives, que le moniteur, au mieux ne sert à rien et, au pire, est un
anxiogène pour les familles.
Bernadette
Kastler, Psychologue
au CRMSN de l’hôpital de Port-Royal.
|
